Ordo Ab Chao : Débunkage de Fake News
« Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés. »
Mark Twain
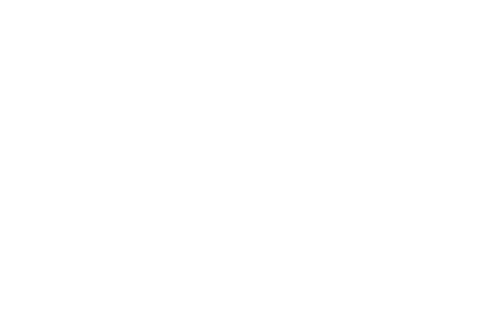
Ordo Ab Chao est un site Web consacré à la lutte contre les « fake news ». Nous fournissons des informations précises et fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Notre équipe de journalistes et de chercheurs expérimentés parcourt Internet à la recherche de fausses histoires et d’informations trompeuses. Nous publions ensuite nos conclusions sur notre site web, afin que vous puissiez être sûr d’obtenir la vérité.
Nous pensons que des informations fiables sont essentielles à une démocratie saine. C’est pourquoi nous nous engageons à fournir au public des informations précises et factuelles.








